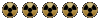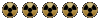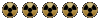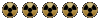flint
Super héros Toxic
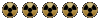
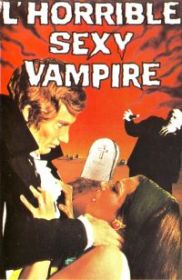
Inscrit le: 13 Mar 2007
Messages: 7606
Localisation: cusset-plage
|
 Posté le: Ven Mar 05, 2010 10:03 pm Sujet du message: [M] [Critique] Les confessions d'un mangeur d'opium Posté le: Ven Mar 05, 2010 10:03 pm Sujet du message: [M] [Critique] Les confessions d'un mangeur d'opium |
 |
|

Les confessions d’un mangeur d’opium – 1962
(Confessions of an Opium Eater)
Genre : Aventures, Exotisme
Pays d’origine : Etats-Unis
Réalisé par Albert Zugsmith
Avec Vincent Price, Linda Ho, Philip Ahn, Richard Loo, June Kyoto Lu, Yvonne Moray…
Autres titres : Souls for Sale/L’Orient érotique/Evils of Chinatown/Le confessioni di un fumatre d’oppio


Je m’appelle De Quincey, je rêve, et je crée les rêves… C’est par cette phrase que s’ouvre ce film quasi-invisible, la voix envoutante de Vincent Price, acteur principal et narrateur, accompagnant un décor presque irréel… une plage, un cheval blanc, un squelette recouvert par les algues.
Au loin, une jonque se perd dans la brume. Pendant près de dix minutes, il n’y aura plus le moindre dialogue, et le spectateur suivra le traitement réservé à de jeunes femmes asiatiques réduites en esclavage. Malmenées, entassées, jetées dans un filet, puis transférées sur un autre navire, sur fond de musique inquiétante, aux accords dissonants, elles seront finalement débarquées sur une plage. Alors que l’hystérie collective gagne les prisonnières, un second groupe fait irruption sur la plage. C’est l’affrontement…


Et puis, nous nous retrouvons à San Francisco, dans le quartier de Chinatown, en 1902. Gilbert De Quincey déambule dans les rues, raconte son histoire, comment il a quitté Londres pour arriver en ce lieu, comment il a découvert l’opium, ses dangers, mais aussi son pouvoir sur le conscient, et le subconscient. Il a fait la connaissance d’un journaliste, George Wah, qui enquêtait sur les Tongs, les luttes que se livrent les sectes secrètes dans le quartier chinois, et sur le trafic de femmes enlevées en Asie et échangées contre de l’opium. A présent, Wah a disparu, certains disent qu’il est mort, qu’on l’a tué. De Quincey pénètre chez un antiquaire, montre le dragon tatoué sur son avant-bras. Ce signe de reconnaissance lui ouvre les portes d’un monde souterrain où de nombreux dangers l’attendent.


Réalisé par Albert Zugsmith, ce film est adapté du roman (presque) éponyme de Thomas De Quincey (1785-1859) : « Les confessions d’un Anglais mangeur d’opium », publié en 1822. Poète, écrivain et journaliste, De Quincey découvrit l’opium lors de ses années d’étude, et en consomma au départ dans un but thérapeutique, car il souffrait de maux d’estomac. Des années plus tard, il deviendra complètement dépendant à cette drogue, ce qui le poussera à écrire cet ouvrage dans lequel il brosse un portrait lucide de son comportement face à l’opium.
Du parcours de l’écrivain, Zugsmith n’a retenu que le nom du personnage, Vincent Price devenant un hypothétique parent de Thomas, aventurier, ainsi qu’une étrange poésie retranscrite dans les premières images du film, les tirades de Price, et la personnification de ses cauchemars après avoir goûté au « poison ». Pour le reste, l’œuvre oscille entre le serial, le pulp tendance Fu Manchu et le voyage onirique prenant parfois des allures de trip hallucinatoire.


Connu essentiellement pour avoir produit ou réalisé des films d’exploitation à petit budget, Albert Zugsmith nous plonge une bonne partie du film dans les bas-fonds de Chinatown, peuplés de méchants chinois, remplis de couloirs mystérieux, de passages secrets, avec une fumerie d’opium clandestine, des femmes enfermées dans des cages, une buanderie où les esclaves sont lavées, parfumées et habillées avant d’être vendues.
Dans ce décor de serial, De Quincey doit découvrir où et quand va avoir lieu la vente aux enchères des esclaves. Dans cette quête, il va être aidé par deux femmes qu’il aura libérées, dont une lilliputienne (Yvonne Moray, premier rôle féminin de « The Terror of Tiny Town », western interprété uniquement par des nains).


« Les confessions d’un mangeur d’opium » laissent une impression mitigée, le sentiment d’être passé à côté d’une expérience cinématographique majeure. L’alchimie entre la poésie, les expériences sensorielles du héros sous l’influence de l’opium et le film d’aventures à l’ancienne ne prend que par intermittences. Comme si les vapeurs opiacées avaient traversé l’écran, le spectateur passe de l’émerveillement à l’endormissement, pénètre dans une quatrième dimension où, tour à tour, l’on voit De Quincey fuir l’ennemi au ralenti, traverser un bar où le temps s’est arrêté, puis sauter d’un toit en se décorporant. Le rythme est inégal et confus, certaines scènes s’enchaînent curieusement, sans réelle logique, et cette longue promenade dans les souterrains de Chinatown ressemble parfois à un parcours balisé pour des touristes embarqués dans un train fantôme.



Le bouquet final offre une série de danses exotiques exécutées par les esclaves, on pense alors à Debra Paget dans « Le Tombeau hindou », on se met aussi à rêver que Fritz Lang aurait pu réaliser « Les confessions d’un mangeur d’opium », et ajouter un autre chef d’œuvre à sa filmographie. En tant que tel, le film de Zugsmith doit beaucoup au talent de Vincent Price, impeccable dans son costume noir et sa casquette de marin, fascinant dans son rôle, moins convainquant dans les scènes d’action. Mais son charisme demeure inaltérable, et il est accompagné par une kyrielle d’Asiatiques fort charmantes, et de la non moins troublante Yvonne Moray, qui, du haut de ses 76 centimètres, méritait bien, en la circonstance, son surnom de « mini Garbo ».
On retiendra aussi, malgré un budget modeste, l’excellent travail d’Eugène Lourié en tant que directeur artistique et responsable des décors. Réalisé en 1962, « Les confessions d’un mangeur d’opium » ne seront projetées dans les salles françaises qu’à la fin de l’année 1969.




 |
|
mallox
Super héros Toxic
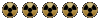

Inscrit le: 10 Sep 2006
Messages: 13982
Localisation: Vendée franco-française
|
 Posté le: Lun Fév 08, 2016 6:57 am Sujet du message: Posté le: Lun Fév 08, 2016 6:57 am Sujet du message: |
 |
|
| Citation: | | Dans cette quête, il va être aidé par deux femmes qu’il aura libérées, dont une lilliputienne (Yvonne Moray, premier rôle féminin de « The Terror of Tiny Town »). |
Elle donne un drôle de cachet supplémentaire au film et lorsqu'elle se retrouve avec Price, le duo fonctionne drôlement bien, se fondant dans un décor mi-exotique, mi-embué de vapeurs d'opium, ce que tu dis d'ailleurs ensuite...
| Citation: | | Comme si les vapeurs opiacées avaient traversé l’écran, le spectateur passe de l’émerveillement à l’endormissement |
Y a une véritable contamination de pellicule en effet.
A la vision, j'ai soupçonné que c'était volontaire. La direction de Lourié semble aller dans ce sens.
C'est juste là que mon avis diverge un peu : je ne trouve pas le parcours si balisé que ça. Au contraire, je le trouve brumeux, comme sous l'effet de substances, comme un rêve-cauchemar éveillé sur la bases d'un film noir et d'infiltration de milieu.
En tout cas graphiquement, c'est superbe. Et le mélange, très audacieux. Evidemment, dans les pattes d'un Fritz Lang, comme tu dis, ...
P.S. : j'ai remis une affiche et surtout des captures dans la critique (flint, veux-tu que j'en mette de nouvelles sur le site ?)
_________________
 |
|