| Le rôle de l'imaginaire dans la découverte |
| Écrit par Chaperon Rouge |
|
Ce séminaire organisé par le Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines se déroulera à Paris dans le 14ème arrondissement, salle de l'Atelier, 77 avenue Denfert-Rochereau entre les mois de février et avril.
Responsables :
Sylvie Catellin, CHCSC, coordinatrice du groupe MECSCIA, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Thomas Widemann, Observatoire de Paris – Laboratoire d'Études Spatiales et Instrumentales en Astrophysique, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Statut :
Séminaire d'enseignement et de recherche.
Horaire :
Lundi 8 février (14h-15h30) : séance d'ouverture Le mercredi, de 14h30 à 16h ou de 16h à 17h30
Lieu :
Observatoire de Paris, salle de l'Atelier, 77 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris (Métro/RER Denfert-Rochereau ou Port-Royal, Bus 38 Hôpital Saint-Vincent-de-Paul)
Présentation :
Les nuits des 11-12 puis 17-18 août 1877, Asaph Hall observe pour la première fois deux petits satellites de Mars, qu'il nomme Phobos et Déimos. La nouvelle de cette découverte ébranle le monde scientifique, mais ne surprend ni les lecteurs des "Voyages de Gulliver" de Jonathan Swift, ni ceux de Voltaire qui, dans "Micromégas", écrivait en 1752: "En sortant de Jupiter, [les voyageurs] traversèrent un espace d'environ cent millions de lieues, et ils côtoyèrent la planète de Mars (...); ils virent deux lunes qui servent à cette planète, et qui ont échappé aux regards de nos astronomes". La découverte scientifique s'enracine dans un contexte historique, culturel et intellectuel. La circulation des textes, des œuvres, la prégnance des mythes constituent un imaginaire collectif à partir duquel savants et artistes puisent leur inspiration et contribuent à l'élaboration des savoirs. En quoi la part d'inattendu, d'illumination, de sursaut durant lequel "les idées surgissent en foule, comme pour se heurter, jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent pour former une combinaison stable" (H. Poincaré), procède-t-elle de relations, souvent inconscientes, avec l'imaginaire et son temps ?
C'est autour de plusieurs exemples précis, empruntés à l'histoire des sciences et des textes - de l'astronomie aux sciences de l'homme - que ce séminaire d'enseignement et de recherche, à destination des chercheurs interéssés mais également des étudiants M2 du master "Arts, Sciences, Culture, Information, Multimédia" de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, propose de conduire une réflexion sur le rôle de l'imaginaire dans la découverte.
Le disque microsillon en or comportant images, langages et sons de la planète Terre, fixé à bord des sondes Voyager-1 et Voyager-2 lancées en 1977 (cliché NASA).
Programme 2010 :
Lundi 8 février 2010 (14h-15h30) - Présentation générale par Sylvie Catellin et Thomas Widemann - "Des planètes aux pulsars : l'imaginaire et l'observation astronomique", par Thomas Widemann - "La sérendipité dans la découverte et son récit", par Sylvie Catellin
Mercredi 17 février 2010 (16h-17h30) - "Sur un aphorisme de Condorcet, chiffres, lignes et imagination", par Jean-Pierre Kahane, de l'Académie des Sciences
Mercredi 3 mars 2010 - "Sur la création en mathématiques : l'erreur comme source ou l'erreur comme risque. Quelques exemples, depuis le mémoire de Poincaré de 1889 sur le Problème des trois corps jusqu'à nos jours", par Martin Andler (UVSQ, Département et Laboratoire de mathématiques et CHCSC/MECSCIA)
Mercredi 17 mars 2010 - "Rendre visible l'invisible : images et imaginaires dans les nanotechnologies", par Marina Maestrutti (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre d'Etude des Techniques des Connaissances et des Pratiques)
Mercredi 31 mars 2010 - "Autour du Songe de Kepler", par Jean-Pierre Luminet (CNRS, Observatoire de Paris - LUTH)
Mercredi 14 avril 2010 - "Un récit de voyage imaginaire à l'origine de la première théorie générale du transformisme", par Laurent Loty (CNRS et Université Paris-Sorbonne Paris IV, Centre d'Étude de la Langue et de la Littérature Françaises des 17e et 18e siècles). |


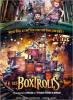











 De février à avril, un séminaire est organisé par le CHCSC à l'Observatoire de Paris sur "Le rôle de l'imaginaire dans la découverte".
De février à avril, un séminaire est organisé par le CHCSC à l'Observatoire de Paris sur "Le rôle de l'imaginaire dans la découverte".
